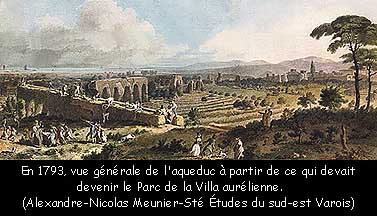| |
L'Antiquité
De tous temps l'eau fut capitale pour l'homme et sa conquête
a nécessité un développement de techniques appropriées
au milieu.
Dès le 3éme millénaire avant JC les Egyptiens creusent
des puits très profonds avec des tiges de bambous.
En Crête 1000 ans plus tard, sont employés
des tuyaux en terre semblables à ceux utilisés en Provence
et ailleurs jusqu'à la fin du 19 éme siècle. |
|
| Dans
l'antiquité, les Grecs ont leurs fontaines publiques, petites,
simples et dépourvues d'ornementation architecturale : une colonne
de marbre blanc forée sur un axe vertical où un tuyau de
plomb conduit l'eau à un dégorgeoir en bronze figurant une
tête de Lion ou un masque de satyre. Bien peu de changement pour
nos fontaines du 19ème S. |
| |
Les Romains généralisent la technique des
aqueducs et dans le Var celui de Fréjus long de 40 km de la source
de la Siagnole à Form Julii en est un bel exemple. |
Le
Moyen-Age
Au Moyen-Age la solution
la plus usitée pour obtenir l'eau dans les villages est la ligne
d'eau où celle-ci descend naturellement par gravité dans
un canal à ciel ouvert.
L'eau va de fontaine en fontaine, la surverse de la première alimentant
la suivante. Les usages différents de l'eau se répartissant
tout au long de cette ligne : au point le plus haut, l'alimentation des
habitants, puis les animaux, les taches domestiques (lavage), l'arrosage
des jardins et des cultures et enfin les besoins des moulins.
Quand l'eau est peu abondante, les fontaines sont rares et fort simples;
le souci majeur des édiles sera donc la recherche de sources régulières,
l'amélioration des captages et l'acheminement de l'eau vers les
différents quartiers des villages qui petit à petit s'étendent.
|
 |
L'Empire
L'administration
napoléonienne est à l'origine de la création
des départements et parallèlement les ingénieurs
des Ponts et Chaussées, en homme de terrain participent à
l'aménagement du territoire et aux travaux d'adduction d'eau.
Des plaques gravées le rappellent à Vidauban, Saint
Maximin, Néoules...
Les matériaux changent et la fonte remplace de plus en plus
la terre cuite qui, poreuse et fragile, provoque des pertes importantes.
L'eau coulant à la fontaine correspondant à la moitié
voire au quart du volume capté à la source. Le prix
de la fonte baissant au cours du siècle va également
favoriser son utilisation. |
|
L'âge
d'or
Le
19ème siècle est l'âge d'or des fontaines et
dans tous les villages, bornes-fontaines, fontaines centrales ou
adossées, fontaines-lavoirs, puits-fontaines dans les plaines
vont voir le jour, dessinées par les ingénieurs des
Ponts et Chaussées, les architectes municipaux , le maçon
voire l'instituteur du village.
Dans la seconde moitié du 19 ème S la technique du
réseau va permettre de multiplier les adductions d'eau. La
résistance des matériaux, le calcul des sections des
tuyaux vont permettre d'augmenter la taille des conduites et donc
le volume d'eau disponible. |
 |
|
|
Collobrières
est la première commune à bénéficier de
cette distribution avec ses 12 fontaines, 14 bouches d'arrosage et le
lavoir public. La loi sur la salubrité de 1902 va accélérer
le développement des réseaux car il est urgent de lutter
contre les épidémies et les fièvres causées
par les eaux polluées des puits.
|
Aujourd'hui
Aujourd'hui
chaque commune, chaque habitation dispose de l'eau courante et
les rôles les plus importants de la fontaine ont disparu.
Heureusement les fontaines du passé gardant leur charme
décoratif, permettent une meilleure compréhension
de l'histoire urbaine, offrent aux artistes peintres ou photographes
des sujets de choix et conservent leur rôle de point d'eau
à boire pour les promeneurs à pied ou à vélo
ou pour tout à chacun ayant soif. On peut regretter que
beaucoup d'entre elles arborent un "Non Potable" alors
qu'elles ont désaltéré des générations,
mais la réglementation a changé... |
 |
|
Certes
la construction des fontaines a beaucoup ralenti mais on constate
que nombre de projets décoratifs d'embellissement urbain
passe par la création d'une fontaine, partie intégrante
de cet espace. |
[retour]
|